XVIIIe siècle
-

Voltaire (1694-1778) a réussi à être l’écrivain le plus lu de son siècle et l’auteur favori des milieux conservateurs, de l’aristocratie et des cours européennes, tout en étant un contestataire majeur de son temps, et en gagnant la subtile réputation d’être l’un des pères de la Révolution française de 1789. Son ambivalence représente un cas singulier de séduction dans la littérature française. L’analyse de ses œuvres dans tous les genres, poétiques, historiques, narratifs, polémiques, suggère que leur succès en leur temps a reposé sur une connaissance, ou une idée, des attentes de son lecteur, pour en jouer avec finesse. On a coutume de voir dans les livres le fruit des idées, des expériences et des rêves de leur auteur ; dans une démarche différente, cet essai cherche à montrer qu’ils s’écrivent aussi dans l’obsession d’être aimé et entendu d’un certain lecteur, qu’il s’agit de séduire.
En 1981, Sylvain Menant nous donnait sa thèse La chute d'Icare. La crise de la poésie française (1700-1750) et l’an dernier son livre le plus récent, Voltaire et son lecteur. Essai sur la séduction littéraire.
Nous sommes heureux pour lui du Grand Prix 2022 de la critique de l’Académie française qui couronne une magnifique carrière de critique.
-

TABLE DES MATIÈRES
Préface, par Daniel Roche
Introduction
Chapitre premier. — L’origine familiale
Les laboureurs
La trajectoire familiale à travers les alliances matrimoniales et les réseaux de relations : du petit commerçant à la noblesse de robe
Jean d’Houry (1611 ?-1678) : alliance et descendance
Après le décès de Jean d’Houry (1678) : une époque de transition
Succession de Claude Dubois (1695)
L’alliance d’Houry-Le Breton (1698)
Les mariages Jombert (1707) : Michel et Marie-Jeanne
Mise sous tutelle d’André-François Le Breton devenu orphelin (1721)
Décès et inventaire de Laurent d’Houry (1725)
L’univers matériel familial à travers les inventaires après décès (1678 et 1725)
L’insertion dans l’espace parisien
Adresses, enseignes et marques
Meubles, linge, vaisselle, bijoux, objets décoratifs, vêtements
Chapitre II. — La production de Jean et de Laurent d’Houry
Un contexte socioculturel favorable aux sciences dans la seconde moitié du XVIIe siècle
L’alchimie et la chimie
Pharmacie, thérapeutique et académiciens
Les sciences médicales
L’obstétrique et la chirurgie
L’apprentissage de Jean d’Houry
Réception de Jean et jalons de sa carrière
L’inventaire après décès professionnel de Jean d’Houry (1678)
Le cadeau de mariage du chancelier : le privilège de l’Almanach royal
Réception et positionnement corporatif de Laurent d’Houry
Les apprentis et la main-d’œuvre de Laurent
La production éditoriale
Les d’Houry et l’imprimerie
Laurent d’Houry imprimeur
Fonds de librairie et matériel d’imprimerie : les enseignements de l’inventaire après décès de Laurent d’Houry (1725)
L’autorat et le statut des éditions d’Houry
Des privilèges et de leur usage
Catalogues d’éditeur et publications périodiques : témoins d’une stratégie éditoriale
Chapitre III. — De Charles-Maurice à Laurent-Charles
Alliances et environnement matériel à travers la documentation notariale (contrats de mariage et inventaires)
Le mariage de Charles-Maurice (1723)
Le mariage d’André-François Le Breton (1741)
Le mariage de Laurent-Charles (1747)
Les inventaires après décès
Présentation et comparaisons
Le détail des inventaires
Les successions
Les papiers, créances et dettes de Charles-Maurice : une situation saine mais modeste
Les papiers, créances et dettes de Laurent-Charles : un patrimoine considérablement accru
Chapitre IV. — De Charles-Maurice à Laurent-charles. Le milieu de la librairie
Le contexte de la librairie au XVIIIe siècle
La carrière de Charles-Maurice d’Houry
Réception et production de Charles-Maurice
La production de Charles-Maurice
La charge d’imprimeur du duc d’Orléans et une position corporative non négligeable
Réception et cursus corporatif de Laurent-Charles
Évolution de la situation fiscale de la famille
La production de Laurent-Charles
Ateliers et main-d’œuvre typographique
Les ateliers, les presses et le personnel d’imprimerie au XVIIIe siècle
Les censeurs, l’inspecteur d’Hémery et les visites de la chambre syndicale
Le contexte socio-culturel
L’autorat médical savant, vivier d’une production spécialisée
Les concurrents des d’Houry en matière de livres médicaux
L’enjeu central de l’Almanach royal
Chronologie éditoriale et intitulés successifs de l’Almanach royal
Genèse, forme et contenu
L’Almanach royal : conflits et enjeux
Laurent-Charles d’Houry à la tête de l’Almanach royal
La diffusion de l’Almanach royal
Une production rémunératrice ? Factums et ouvrages de ville
La famille d’Orléans
L’Ordre de Malte
La production se diversifie
Des possibilités liées aux associations et aux permissions tacites
Le Dictionnaire de Trévoux
Laurent-Charles d’Houry et les Panckoucke
Prospectus et souscriptions
Les acquisitions de fonds
La réponse au développement des sociétés royales d’agriculture et des académies scientifiques : une orientation temporaire vers les ouvrages d’agronomie
Les demandes de privilèges chez Charles-Maurice et chez Laurent-Charles
Éditions et privilèges partagés
Part des nouvelles éditions et des reprises
Les catalogues, outils de diffusion
Le prix des livres neufs
Titres des éditions d’Houry annoncées par le Journal de la librairie entre 1763 et 1778
Le prix des livres d’occasion
Pour une étude de la diffusion des éditions d’Houry
Les imprimeries et librairies des d’Houry : le témoignage des inventaires après décès et des ventes
L’inventaire après décès professionnel de Charles-Maurice (1755)
La vente de l’imprimerie et de la librairie d’Élisabeth Laisné à Nicolas-Léger Moutard (1776)
Inventaire après décès professionnel de Laurent-Charles (1786)
Chapitre V. — La fin de la librairie
Le mariage d’Anne-Charlotte d’Houry (1749-1828)et de François-Jean-Noël Debure (1743-1802)
Descendance et contestations : succession de Laurent-Charleset affaire Merlin
L’association Debure-d’Houry et ses premières vicissitudes
Un banquier : François-Jean-Noël Debure
Livres et finances en Révolution
Une faillite exemplaire (1790)
Créancier des Debure-d’Houry et faussaire : le libraire Guillot
L’étendue de la faillite et les comptes de la famille Debure-d’Houry
Débiteurs professionnels des Debure-d’Houry
Liquidation et divorce (1791-1793)
Le catalogue de la vente de la librairie Debure-d’Houry
Après la Révolution française : remariage et nouveaux déboires d’Anne-Charlotte d’Houry
Décès et succession d’Anne-Charlotte d’Houry : l’extinction d’une dynastie ?
Actif mobilier de la succession
Immeubles de la succession
Les descendants
En guise d’épilogue
Conclusion
Sources et bibliographie
Catalogue chronologique des ouvrages édités par les d’Houry
Annexes
Index des noms
Si la famille d’Houry, aux origines fort modestes, acquiert nom et fortune dans la librairie parisienne grâce à l’Almanach royal (dont Laurent d’Houry obtient le privilège à la fin du XVIIe siècle), elle a commencé bien plus tôt à spécialiser sa production dans un domaine scientifique, médical en particulier, en phase avec l'édification en cours du réseau académique français et d'une « République des sciences » entre « Grand Siècle et Lumières ». Cette étude montre sur le temps long que ce parti éditorial précurseur de la maison d'Houry est indéniable, sans que pour autant sa viabilité soit assurée dans la durée, en raison d’un créneau professionnel encore étroit et surtout de la concurrence croissante d’autres maisons parisiennes. D’où les compléments essentiels qu’apportent à l’entreprise l’Almanach royal et l’établissement d’une imprimerie permettant une plus grande autonomie de production mais obligeant aussi à élargir le répertoire et à s’assurer d’autres marchés plus directement « alimentaires » (factums, travaux de ville, impressions au service de la famille d’Orléans et de l’ordre de Malte). À l’instar des Jombert, c’est la déstabilisation révolutionnaire qui viendra révéler les fragilités d’une entreprise étroitement dépendante, en fin de compte, des protections collectives et individuelles dont bénéficiait la librairie parisienne d’Ancien Régime.
-

TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos
Par Emmanuelle Hénin
Note de l’auteur
PREMIÈRE PARTIE
ARTS PROFANES
Introduction à la première partie
Par Pouneh Mochiri et Lise Wajeman
1. Anecdotes et théorie subreptice de l’art
Donner à ne pas voir
La laideur de Giotto
Un récit « petit et difforme »
La symétrie faussée
Une théorie subreptice de la peinture
L’or feint.
Les paradoxes de l’or dans la théorie de la peinture
L’art vaut de l’or : théories de la valeur marchande
Souci mercantile et spéculation humaniste
L’exclusion de l’or
Éclat de l’or et manière du peintre
Éclat de l’or et perturbation du nouvel ordre pictural
2. Natures mortes et vanités : Chardin, Damien Hirst
Le regard dédoublé
La transpiration de la couleur
La sublimation du dégoût
In vanitate veritas
La raie, telle qu’en elle-même la peinture se change
La cuisine en tous ses états
La chair de la couleur
L’envers du sexe
La danse de mort
Le regard du chat
L’oeil de Méduse
L’écriture Chardin
L’apprentissage de la cécité
Entre dégoût et plaisir : le bénéfice de la contradiction
Entre chien et chat : des yeux pour ne point voir
Le travail de la méconnaissance
Fenêtre aveugle : Les Bulles de savon de Chardin
Damien Hirst et la vanité de la peinture
Une vanité provocatrice
Le chef d’oeuvre absolu : l’art de battre tous les records
Sotheby’s, 2008 : Bulla speculativa
L’idée la plus chère de l’histoire de l’art
La Wallace Collection, 2009-2010 : vanité de la peinture
Post-Scriptum
P.‑P.-S.
DEUXIÈME PARTIE
THÉOLOGIE DES IMAGES ET EXÉGÈSE
Introduction à la deuxième partie
Par Guillaume Navaud
1. Théologie des images
Le plaisir des images, entre théorie profane et théorie sacrée : de l’ambivalence à la sacralisation
Entre séduction et effroi : l’ambivalence envers le plaisir pictural
Les trois voies de la réhabilitation
Le plaisir comme processus translatif
Une « sacralisation » du plaisir
Peintre rusé et pape obtus : les dessous d’une anecdote
sur le plaisir des images, chez Vasari et Ottonelli
Généalogie de l’anecdote
Les bizarreries de la version vasarienne
Les dessous de l’affaire
La version d’Ottonelli et Pietro da Cortona
Les dessous d’une contradiction
Le regard détourné. L’aveuglement à l’image, en théologie et en peinture, au xvie siècle
Des yeux pour ne point voir. L’idolâtrie dans la théologie des images au xvie siècle
Entre mutisme et logorrhée, crime et aberration, objet et culte : les fluctuations de l’idolâtrie
Translatio et signe
Les trois faces de l’imbécillité : l’idiota, l’infirmus et le stolidus
Théorie sacrée et théorie profane
Technique efficace et effet séducteur
De la Relique à l’Image. Le Saint Suaire dans la théologie des images
La fonction totémique : de la relique au symbole
La prise du pouvoir par le suaire : la triade acheiropoïète
Les fluctuations de la matière
La Passion de l’Image
Un sang incombustible
L’image invisible
L’au-delà de la peinture
Le voile de Parrhasius
2. Exégèse et interprétation
L’énigme invisible : quelques remarques sur l’énigme en peinture, à propos d’une Annonciation de Piero della Francesca
L’énigme écran : le double portrait de l’École de Fontainebleau
L’énigme en suspens : l’Annonciation de Piero
Les quatre temps du déchiffrement
Une côte en trop
Le double excès de l’interprétation
Pli selon pli : le déploiement de l’explicatio
L’économie du ressassement
Le superflu et le nécessaire
L’excégèse : l’inflation de la côte et le débordement du commentaire
« Signifying nothing ». Macbeth et le refus de l’interprétation
Refus, absence et manque : trois interprétations de l’insignifiance
Les deux couches de sens
Le premier contexte : un rien aux couleurs du deuil
Le deuxième contexte : l’ombre de la somnambule
L’arrêt des signes
Le troisième contexte : la prophétie mortelle
Le dernier contexte : rien n’existe que le néant
TROISIÈME PARTIE
ART DE LA SCÈNE
Introduction à la troisième partie
Par Zoé Schweitzer et Enrica Zanin
1. Théâtre et vision
Vision de loin, vision de près : les enjeux d’un paradigme pictural dans Le Véritable Saint Genest
La littéralité de l’illusion
Les deux faces de la vérité
La question de la distance : deux manières de peindre
Dramaturgie de l’accommodation et tragique de la cécité
Réécriture racinienne du crime et réécriture d’un crime racinien : Andromaque et ses adaptations anglaises
Un crime qui n’en finit pas de se réécrire
Réécrire Racine
Le meurtre en scène
Beaumarchais et la dramaturgie de l’hallucination
Les origines d’une scène d’hallucination
Une scène à effet
Hallucination et dynamique des passions
Une théorie latente de l’hallucination
Un théâtre de la faute : hallucination et culpabilité
La jouissance subreptice : hallucination et désir
2. La scène et l’obscène
Médée, la volupté d’un geste lent
Au-delà de l’infanticide, la volupté
Façons sénéquiennes de tuer un enfant
La purgation des passions sexuelles
L’« abominable jouissance » : Sénèque avec Sade
Jeux avec la censure : Molière et la stratégie de l’obscène (À propos de Tartuffe, IV, 5)
Un néologisme, « le plus joli du monde »
Préhistoire de l’obscène : des images au théâtre
La double face de l’obscénité
Trois positions possibles : polémique, prophylaxie, provocation
L’École des Femmes : retournement de l’équivoque et effet de contamination
Une scène à (ne pas) faire
L’inversion des codes sexuels
Le cocuage à l’envers
La titillation voyeuriste : jusqu’où aller trop loin ?
Une audace plus insidieuse : la distribution des rôles
La provocation ultime : l’obscénité cathartique
La guerre des syllabes : l’érotisation de la langue au xviie siècle
Le « congrès », du juridique à l’obscène
Châtrer les syllabes immodestes
Manipulations théâtrales des « syllabes sales »
La syllabe la plus infâme
Provenance des textes
Bibliographie des publications de François Lecercle
Index nominum
Liste des figures
-

Au siècle des Lumières le monde du livre en France apparaît des plus réglementés, marqué qu’il est par l’encadrement censorial, le contingentement des places d’imprimeur, la surveillance policière et corporative et une apparente « anémie provinciale ». À Paris comme en province, notamment en Basse-Normandie, les Lumières et leurs livres (prohibés ou non) se propagent néanmoins, ainsi qu’une foule de contrefaçons et de livrets de colportage. Or les libraires en titre ne sont pas, loin de là, les seuls agents d’une telle diffusion. Tout un réseau de « libraires forains », originaires pour la plupart des environs de Coutances, y contribue activement, dans un large quart nord-ouest du royaume. Ce monde grouillant ressemble à celui qu’a décrit Robert Darnton à travers les correspondants de la Société typographique de Neuchâtel, mais son ancrage remarquable en Basse-Normandie donne à ce volume de la Prosopographie des gens du livre en France au XVIIIe siècle sa coloration particulière. Si parmi ses 592 notices biographiques figurent certes 250 Caennais, on y compte aussi une centaine de libraires forains et de colporteurs de livres issus du petit village de Muneville-le-Bingard (Manche).
-
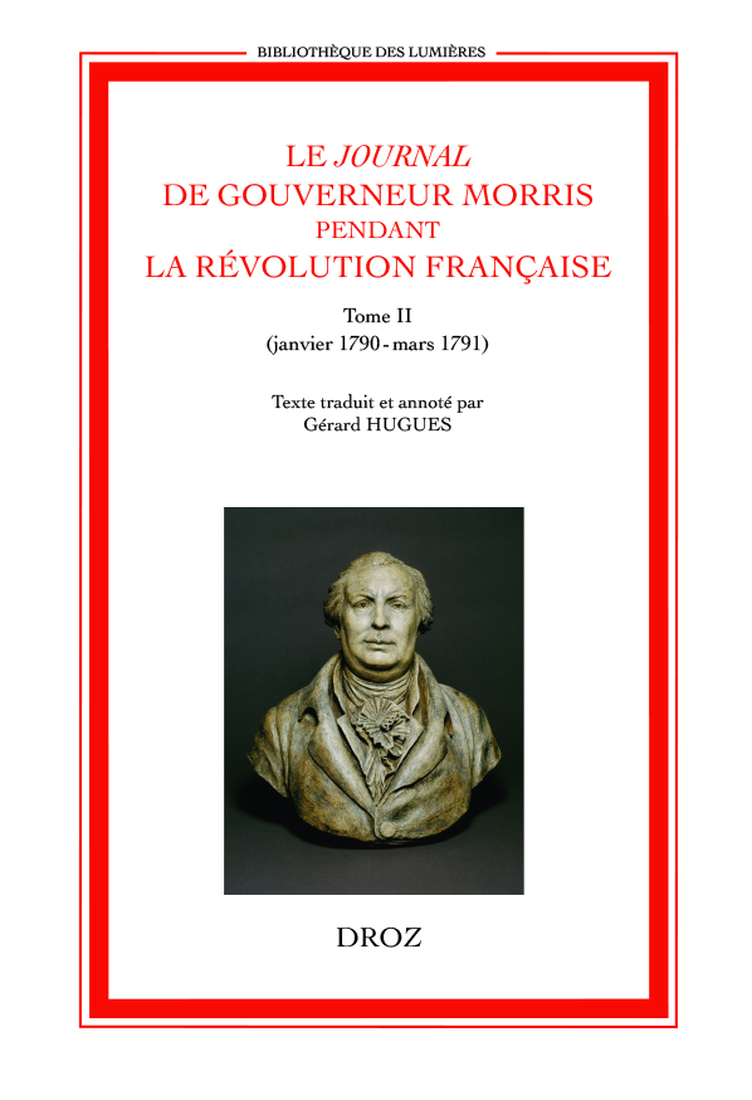
Après la fièvre de 1789, l’année 1790 s’annonce plus paisible pour Gouverneur Morris. Il continue à suivre de très près les progrès d’une Révolution qu’il consigne soigneusement dans son Journal, prodiguant conseils et mises en garde aux plus hauts personnages de l’Etat. Dans le même temps, il persiste à se complaire dans la vie de salon, tout républicain qu’il soit, et entretient avec sa maîtresse, madame de Flahaut, une liaison de plus en plus orageuse. Le calme relatif des affaires lui permet d’accomplir son grand tour de l’Europe du nord, où il peut juger de la percée des idéaux révolutionnaires venus de France. Il admire les chefs d’œuvre de la peinture flamande tout en continuant de négocier âprement les termes du remboursement de la dette américaine avec les banquiers néerlandais. De retour à Paris, déçu par l’adoption d’une constitution qu’il désapprouve parce qu’elle affaiblit le pouvoir du monarque, il s’efforce de venir en aide à la famille royale au point d’être personnellement mêlé aux tentatives de fuite.
-
De la Renaissance à la fin du règne de Louis XIV, la poétique dramatique française se développe et se transforme au rythme des apparitions de Médée. La première tragédie à l’antique imprimée en français, la pièce fondatrice du tragique cornélien, l’œuvre emblématique du théâtre à machines, la riposte des Anciens aux Modernes : toutes mettent en scène la barbare magicienne. Toutes convoquent une figure du mal.
Si Médée participe aussi activement à la définition du théâtre, c’est qu’elle en incarne la mémoire. En matérialisant ses sortilèges, sa passion et ses crimes, l’art dramatique joue sur le plan de l’autoréférentialité : il (se) rappelle qu’il jaillit d’une brèche dans les fondations de la polis, qu’il puise sa force vitale à l’ombre des règles pensées pour délimiter l’acceptable. Et de cette réminiscence, il tire l’énergie nécessaire pour se redéfinir : rappeler le chaos originel, c’est aussi repenser son mode de répression.
-

Dans son acception conceptuelle large, qui se développe depuis la fin du XIXe siècle, la notion d’imaginaire s’est étendue ces deux dernières décennies au champ de la linguistique. L’imaginaire des langues a suscité des recherches novatrices portant aussi bien sur l’historiographie du discours de promotion de la langue française et sur les représentations des styles littéraires, que sur le pluri- et multilinguisme dans les territoires de la francophonie ou encore la pratique des langues régionales. L’on ne peut toutefois envisager un imaginaire identitaire, quel que soit son champ d’application, sans le penser en regard d’une altérité linguistique. Or, entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe, se développe une intense réflexion sur les langues suscitée par la convergence de divers faits politiques et culturels : reconnaissance en Europe des langues vernaculaires comme langues nationales, concurrence du latin comme réceptacle et véhicule de la culture lettrée, confrontation avec les langues « exotiques » mises en lumière par la vaste entreprise de colonisation et d’évangélisation des espaces amérindien, asiatique et africain. Autant de situations propices à la perception d’une altérité dans la mise en contact des langues que de cas constitutifs de l’identité linguistique. Cette tension entre identité et altérité affleure dans les traités de l’époque destinés à promouvoir la langue vernaculaire ou, au contraire, à légitimer la diversité linguistique. Elle s’éclaire aujourd’hui, dans un anachronisme fécond, des réflexions sur la polyglossie et le multiculturalisme. Elle se prolonge, ou se redouble, à l’intérieur du même espace linguistique, par les partis pris lexicaux, stylistiques, génériques qui constituent autant de langages singuliers diffractant en de multiples éclats une même langue. Ce volume permettra dès lors d’explorer le champ de déploiement de l’imaginaire des langues, dans ses modes de représentation de l’altérité linguistique, sur un plan à la fois linguistique, culturel et littéraire, qu’il s’agisse de revendiquer, voire de construire, une langue identitaire et distinctive, d’accepter ou de refuser la pluralité linguistique, d’envisager dans la rivalité ou l’harmonie la langue de l’autre ou encore de construire par l’écart ou l’acquisition une identité linguistique.
-

Table of contents / Table des matières : Foreword of the Editor-in-chief / Avant-propos du rédacteur en chef – La Font de Saint-Yenne : publier sur l’art, l’architecture et la ville – F. Ferran, F. Moulin & É. Pavy-Guilbert, « Introduction » – I. La Font de Saint-Yenne, critique parmi les critiques et les artistes – C. Le Bitouzé, « Logiques de constitution d’un recueil d’écrits sur l’art : la collection Deloynes (1673-1808) » ; I. Pichet, « Le dialogue des morts dans la Collection Deloynes » ; L. Pelletier, « Dans l’ombre de La Font de Saint-Yenne. Saint-Yves et les Observations sur les arts de 1748 » ; N. LESUR, « Les académiciens face à la naissance de la critique de Salon : l’exemple de Jean-Baptiste Marie Pierre (1714-1789) » – II. La Font de Saint-Yenne, théoricien de l’art – P. Frantz, « La Font de Saint-Yenne dans le contexte des Lumières » ; D. Kluge, « La nouvelle édition des Réflexions (1752) et sa version originale (1747) : entre dépendance et indépendance » ; E. Lavezzi, « La Font de Saint-Yenne lecteur de Du Bos » ; A. Gaillard, « Une peinture au passé ou au futur : l’enjeu du choix du sujet dans la constitution d’un espace public des Réflexions (1747) aux Sentiments (1754) de La Font de Saint-Yenne » ; É. Jollet, « La question de la solidité dans les écrits de La Font de Saint-Yenne » ; – III. La Font de Saint-Yenne, penseur de l’architecture et de la ville – N. Lemas, « La Font de Saint-Yenne et la littérature des embellissements des années 1740-1760 » ; S. Pujol, « À L’Ombre du grand Colbert. Quand l’architecture dialogue avec la politique » ; R. Wittman, « Un La Font de Saint-Yenne méconnu : les textes sur l’architecture publiés après 1760. Victor Louis (1761-2) et Piganiol de la Force (1765) » ; K. De Beaumont, « The Marquis de Marigny, L’Ombre du grand Colbert and the Genius of Gabriel de Saint-Aubin » ; S. de Jong, « En dialogue avec la ville : La Font de Saint-Yenne et l’expérience architecturale et urbaine de Paris » ; F. Moulin, « Le péristyle et l’obstacle : remarques sur une esthétique du regard chez La Font de Saint-Yenne » – « MISCELLANÉES » – L. MALL, « Ce qu’il en est de ce qui est : expérience (et) critique dans Le Neveu de Rameau de Diderot » ; C. Vincent, « La Fable des abeilles et Le Neveu de Rameau » ; S. KARP, « Diderot, Narychkine et la "civilisation" de la Russie » ; A.WALL, « Hubert Robert et le carnet de Brême : temps et espaces dans son art du dessin ».
-

Sommaire
Écrire pour Saint Denis
O. Guyotjeannin, A.-M. Helvétius, "Écrire pour Saint Denis" ; M. Heinzelmann, "La passion Gloriosae de Saint Denis" ; A.-M. Helvétius, "La deuxième version latine de la passion saint Denis" ; K. Krönert, "La passion de saint Denis écrite par Hilduin : le travail d'un historiographe ou l'œuvre d'un faussaire?" ; S. Efthymiadis, "Les premières traductions grecques : la Passion anonyme et la Passion de Méthode" ; C. Förstel, "L'Éloge de Denys l'Aréopagite par Michel le Sancelle : tradition et sources" ; M.-F. Auzépy, "La Vie de Denys l'Aréopagite par Michelle le Syncelle : la Palestine et les carolingiens" ; A. Binggeli, "Les traditions hagiographiques orientales liées à Denys l'Aréopagite" ; I. Perczel, "La pseudo-autobiographie de Denys l'Aréopagite dans le contexte du corpus dionysien syriaque" ; B.-M. Tock, "Les chartes épiscopales pour l'abbaye de Saint-Denis, milieu du XIe - milieu du XIIe siècle" ; R. Grosse, "La collection de formules de Saint-Denis" ; T. Waldman, "Saint-Denis au XIe siècle : un nouveau départ" ; L. Morelle, "J.-L. Lemaitre, "Les nécrologues de Saint-Denis" ; O. Guyotjeannin, "La fabrique du Cartulaire blanc" ; P. Bertrand, "Les documents comptables de l'abbaye de Saint-Denis (XIIIe et XIVe siècle) autour de chaînes d'écritures" ; B. Bove, "Un registre contre la crise : le Livre vert de Saint-Denis (1411)"
Écrire à Saint-Germain-des-Prés du XVIe au XIXe siècle
O. Poncet, "Écrire à Saint-Germain-des-Prés du XVIe au XIX siècle" ; V. Weiss, "La gestion domaniale à Saint-Germain-des-Prés : le cas d'un conflit de censive au XVIe siècle" ; D. Roussel, "Écrire le conflit : pratiques sociales et pouvoirs de l'écrit dans les sources judiciaires à Saint-Germain-des-Prés (XVI-XVIIe siècles)" ; M.-F. Limon-Bonnet, C. Nougaret, "L'écrit dans l'écrit : papiers d'affaires et papiers personnels dans les inventaires après décès dressés dans le quartier Saint-Germain-des-Prés (première moitié du XIXe siècle)" ;
Nommer et décrire les actes des notaires de l'époque moderne, du XVIe au XIXe siècle
O. Poncet, "Nommer et décrire les actes des notaires de l'époque moderne, entre théorie, pratique et histoire" ; M. Ollion, "Minutes et brevets, registres et répertoires : note sur la pratique des notaires du Châtelet de Paris aux XVIe et XVIIe siècles" ; M.-F. Limon-Bonnet, C. Nougaret, "Méthodologie et construction des bases Minotaure-ARNO des Archives nationales : quels éléments pour un glossaire des typologies d'actes ?"
Bibliographie (Comptes rendus critiques ; Notes de lecture ; Livres reçus) ; Chronique
-
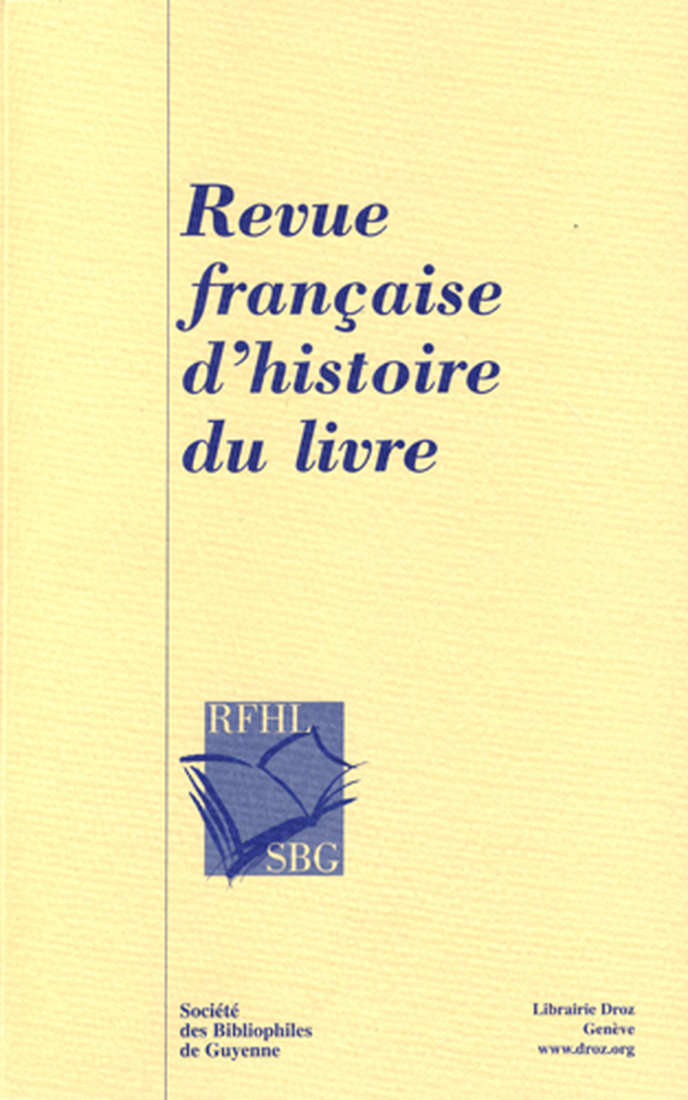
Sommaire: Études - Actes du LXXe colloque de la Fédération historique du Sud Ouest
(Bordeaux, 30 septembre-1er octobre 2017 : Archives, manuscrits et imprimés) - M. NAVARRO CABALLERO, « Les Inscriptions latines d’Aquitaine : les archives de la population romaine d'Aquitaine »; F. LAINÉ, « Nécrologes et obituaires du Sud-Ouest.
Du manuscrit à l'édition »; S. LAVAUD, T.-L. ROUX et A. STELLA, « L'écrit municipal à Agen au Moyen Âge »; S. DRAPEAU, « Instantané d'un chantier hors norme : la comptabilité de l'œuvre de Saint-Michel de Bordeaux (1486-1497) »; J.-P. POUSSOU, « De l'importance et du rôle de l'information durant les grandes crises politiques anglaise et française du milieu du XVIIe siècle »; G. TAFFIN, « Modalités de conservation et enjeux actuels des archives des juges-consuls »; L. COSTE, « Le mémorandum d'Antoine Gautier : de l'écriture à la diffusion »; F. CADILHON, « Thérèse Desqueyroux : François Mauriac et ses voisins »; S. MIQUEL, « Inventaires floristiques et archives botaniques
en Périgord »; S. HOLGADO et C. JACOBS, « Gardien du temps ou l'éternel recommencement, du XVIIIe siècle à nos jours : une bataille impossible contre les misères du temps »; M. AGOSTINO, « La préservation d'un document exceptionnel
au cinéma. Le cas de deux films, Le Nom de la rose et Citizen Kane » ; A. ROQUAIN, « À propos de deux livres ayant appartenu à Lope de Vega : Il gentilhuomo et Avvertimenti morali de Muzio / Épitomé de Florus et Histoire de Polybe » ; F. ROUGET, « La réception éditoriale posthume des Œuvres de Philippe Desportes (1611-1621) »; H. VAN DER LINDEN, « Un ensemble de rares publications éphémères françaises du XVIIe siècle (Harvard, Houghton Library, *88-474a) : aperçu et inventaire »; M. JAOUHARI, « Les manuscrits arabes du général Daumas (1803-1871) » - II. Variétés - Lyse SCHWARZFUCHS, « Devises et marques dans le livre imprimé en terre francophone au XVIe siècle : Paris, Lyon, Genève »; A. GALLET, « La monographie botanique » Comptes rendus.